Sciences et Fictions | Rudyard Kipling et l'enchantement de la technique | Session 5
Y a-t-il un imaginaire scientifique national ?
Index
Thématique : Asimov (Isaac) , Babbage (Charles), Bacon (Francis), Barrett (D. & M.), Bohr (Niels), Bourdieu (Pierre), Campbell (John W.), Cartmill (Cleve), causalité, cinéma, comportements collectifs, Comte (Auguste), Copenhague (école), Descartes (René), économie-monde, éducation, Einstein (Albert), En marge de la profession, expérience de pensée, expérimentation scientifique, Fichte (Johann), fiction spéculative, génie national, Gibson (William), guerre, Heinlein (Robert A.), Houellebecq (Michel), Hume (David), hypothèse scientifique, identité narrative, imaginaire, imaginaire national, imaginaire scientifique et technique, induction, informatique, ingénierie, ingénierie sociale, ingénieur, L'OEil d'Allah, langue, Lehman (Serge), lois physiques, Maurois (André), Nobel (prix), Nulle part à Liverion, objet technique, patriotes, psychohistoire, psychologie, quantique, rationalité, Sans fil, savant, science arabe, Simmons (Dan), Sterling (Bruce), théories scientifiques, thermodynamique, Vance (Jack), Verne (Jules), vitesse, Westfahl (Gary)
Plan
- Les langages de l’imaginaire scientifique
- La fin de l’universalisme?
- Babbage, un cas d’école
- Des politiques nationales de la recherche
- Le poids de Son regard
- La Nation quantique
- Sous les drapeaux, l’espace !
- Intrications
- Et les sciences sociales ?
- Where no man has gone before...
- Synthèse
Texte intégral
Simon Bréan définit les termes du débat: “l’imaginaire” est un ensemble dynamique d’images et de représentations. Il ne s’agit pas que d’un répertoire, mais aussi du processus par lequel ces images sont rassemblées (ce qui renvoie à la notion de “champ de force” évoquée par Bourdieu, après Simondon); “l’imaginaire scientifique” recouvre, quant à lui, un ensemble dynamique d’images en rapport avec la science. Simon Bréan propose de limiter la discussion aux sciences “exactes”. Il rappelle toutefois que, en littérature, l’imaginaire scientifique ne distingue pas clairement théorie et l’ingénierie; d’où l’importance qu’y prennent les objets. Enfin, l’imaginaire scientifique peut être celui d’un auteur (Kipling), celui d’une classe sociale (les ingénieurs), ou d’une nation toute entière (l’Angleterre). Il faut procéder par comparaison-opposition, cherchant ce qui différencie l’imaginaire scientifique d’une nation par rapport à une autre. L’époque joue également: on ne peut définir un imaginaire scientifique national qu’à une certaine époque, pas dans l’absolu. Pour en revenir à Kipling, il faudra tenter de déterminer en quoi il est représentatif de l’imaginaire scientifique anglais de la fin du XIXe siècle.
Le modérateur propose d’examiner deux questions :
-
1) Quels sont les éléments opératoires pour définir un imaginaire scientifique ?
-
2) Quels sont les éléments opératoires pour qualifier un imaginaire de national ?
-
Il faudra ensuite savoir dans quelle mesure les résultats obtenus sont objectifs, et s’ils ne sont pas eux-mêmes des représentations, des expressions subjectives d’un “génie national” qui suppose une appropriation idéologique de la technique, au même titre, par exemple, que l’impérialisme.
Les langages de l’imaginaire scientifique
Le débat s’ouvre par l’éducation: n’est-elle pas la source première de l’imaginaire national, et en particulier, scientifique ? Roger Bozzetto pense que si l’école donne une direction à l’imaginaire scientifique, c’est parce qu’y sont évoquées les grandes figures de la science : la France insiste sur Descartes, tandis que l’éducation anglaise met en avant Hume et Locke, anti-cartésiens. Daniel Tron rappelle que le côté cartésien est inscrit dans la syntaxe de la langue française et que la pensée empiriste est au cœur de la grammaire anglaise : la façon de percevoir la culture et, ici, la science — et, par conséquent, de construire un imaginaire — est fonction de l’apprentissage même du langage, et commence peut-être dès avant l’école. Simon Bréan cite Les Langages de Pao de Jack Vance, où l’auteur traite de la modification d’une société par la langue.
Parler une langue, c’est « penser la réalité d’une manière différente ». La langue française est remplie de connecteurs logiques; elle est animiste, puisqu’elle confère un genre aux objets (le mur, la porte, etc.). En anglais, en revanche, les temps et les modes grammaticaux ne se comprennent qu’en contexte (la différence se retrouve dans la différence entre l’ordonnancement très géométrique des jardins à la française, qui imposent une rationalité, et celui très empirique des jardins à l’anglaise, qui proposent un chemin de découverte). À l’autre bout des études, cela se ressent aussi dans les modalités et les formes adoptées par la recherche : des essais français et anglais seront rédigés de façon très différente. Le premier sera structuré en deux ou trois parties, distinctes et complémentaires, évitant les répétitions à tout prix, tandis que le second tournera autour de la notion qui en est le sujet, n’hésitant pas à mettre en place des raisonnements que l’on sait transitoires. Or, insiste Daniel Tron, la production d’écrits est au cœur du processus scientifique depuis l’aube de la Modernité. Par conséquent, l’éducation et la langue sont nécessairement constitutives d’un imaginaire scientifique national. Pour autant, comme le souligne, Katariina Roubier la langue n’est pas le seul élément constitutif d’une nation, pas plus que, pris séparément, le territoire ou l’existence d’un État.
Revenant sur la recherche, Ugo Bellagamba se demande si la langue n’explique pas aussi que les productions américaines soient parfois plus prisées que les productions européennes ou françaises, et publiées dans des revues jugées plus prestigieuses. Danièle André remarque que, s’il y a une tradition d’échange de chercheurs de deux côtés de l’Atlantique, on peut y déceler, a contrario, l’attrait des États-Unis pour les plus talentueux chercheurs du Vieux Continent. Daniel Tron relève une pollinisation de la recherche par l’anglais, comme l’atteste, dès 1945, le passage du terme français “technique” au terme anglo-saxon ”technologie”.
Ugo Bellagamba ajoute que le langage scientifique peut être instrumentalisé par une idéologie nationaliste qui cherche à se justifier. Ainsi, les Discours à la Nation allemande de Fichte: le pangermanisme qui s’y exprime s’appuie sur la Nature telle qu’elle est vue par l’imaginaire scientifique allemand pour justifier la supériorité du peuple allemand, et, par richochet, la légitimité, pour ce dernier, de se rassembler sur un seul et même territoire. De ce point de vue l’imaginaire scientifique national devient une arme politique.
La fin de l’universalisme?
Roger Bozzetto et Timothée Rey se penchent sur l’absence d’un imaginaire scientifique universel après 1914: alors qu’il existait une “économie-monde” centrée sur France-Allemagne-Angleterre jusqu’à la fin du XIXe siècle, l’Europe abandonne sa candeur quant au progrès technique après la première guerre mondiale. Elle s’éloigne ainsi de l’optimisme américain, qui ne tombe qu’après Hiroshima, les États-Unis continuant à produire jusqu’en 1945 des articles à la tonalité très optimiste. Deux imaginaires scientifiques se forgent et s’éloignent, selon la vulgate évoquée par Simon Bréan.
Sylvie Denis voit surtout la cause de ce décalage dans la mort au front d’un grand nombre d’auteurs et de scientifiques européens qui auraient pu, s’ils avaient vécu, continuer à la vigueur de l’imaginaire scientifique. Daniel Tron recherche la source d’un imaginaire scientifique national dans la manière dont un peuple se dote d’auteurs et de savants susceptibles de représenter son identité. Il évoque la notion “d’identité narrative”. Par exemple, le fait de prendre des notes, « la consignation des faits observés » est déjà constitutif de la science dans l’imaginaire anglo-saxon. D’ailleurs, comme le rappelle Daniel Tron, dans «En marge de la profession», Kipling pointe du doigt le scientifique indélicat qui théorise trop tôt par rapport au petit nombre d’observations qu’il a effectuées.
Babbage, un cas d’école
Éric Picholle évoque Le Déclin de la science1, du mathématicien britannique Charles Babbage. Suggérant paradoxalement à ses compatriotes de s’inspirer des Français, cet ouvrage peu connu chez nous mais déterminant pour la conception anglo-saxonne de la science établit une liste de « mauvaises pratiques » scientifiques. On peut identifier chez Kipling une posture épistémologique voisine: le refus d’une mauvaise science, plutôt que l’apologie d’une science idéalisée, comme c’est le cas, en France, chez Jules Verne.
Le caractère national de sa réception se retrouve en littérature. Les références à Babbage sont extrêmement rares dans la science-fiction française, alors que le steampunk anglais le porte au pinacle avec par exemple La Machine à différences de Bruce Sterling et William Gibson, en 1990. Pour Timothée Rey cela relève bien de la construction d’un “génie national” : le scientifique, ou l’auteur de science-fiction, français se voit volontiers cartésien, et le scientifique ou l’auteur anglais fait référence à Bacon (partisan, comme le rappelle Jean-Luc Gautero, des listes de faits et des tableaux), Babbage, et les grands scientifiques américains. Simon Bréan fait toutefois remarquer que Babbage lui-même se réclame de Descartes.
Si certaines idées maîtresses se révèlent universelles, leur assimilation par une culture étrangère passe souvent par une réécriture nationale. Cela se vérifie également en science-fiction, où les objets techniques et les découvertes scientifiques tendent à devenir des personnages à part entière du récit.
Il y aussi le cas, évoqué par Louis Butin, d’un théoricien français devenu l’inspirateur d’un imaginaire scientifique étranger: c’est le cas du Brésil, qui a adopté l’ordem e progresso d’Auguste Comte comme devise nationale. L’esprit positif y reste très vivace.
Simon Bréan recentre le débat: la clef de la discussion réside bien dans l’articulation entre imaginaire scientifique et identité nationale.
Des politiques nationales de la recherche
La distinction s’opère aussi sur les plans administratifs et sociologiques, liés à la façon dont chaque pays se dote d’une élite intellectuelle scientifique. Éric Picholle rappelle que, en France, Polytechnique ou l’École Normale Supérieure constituent des cadres à la fois contraignants et protecteurs, qui définissent l’élite républicaine au terme d’une longue sélection. Les honneurs comptent aussi beaucoup dans la construction de cet imaginaire scientifique national : l’attribution du prix Nobel ou de la médaille Fields constituent autant de distinctions qui, selon Claude Ecken, peuvent orienter l’évolution de la recherche nationale sur tel ou tel champ d’étude. La très bonne réputation des mathématiciens français en est un exemple. Cela débouche naturellement sur des modification des politiques nationales de la recherche.
De même, à l’échelle européenne, la prise de conscience d’une identité collective rejaillit sur les cadres de la recherche et la production de l’imaginaire scientifique. Estelle Blanquet évoque ainsi les investissements européens récents en faveur de la diffusion du savoir scientifique comme l’un des éléments constitutifs d’une identité européenne : « Pour traiter les rapports entre la science et la société dans le cadre de politiques judicieuses, les connaissances accumulées dans l’histoire, la sociologie et la philosophie des sciences doivent être étendues, consolidées et diffusées à l’échelle européenne. À cette fin, les universitaires spécialisés dans ces disciplines devraient former des réseaux pour structurer la recherche et le débat de manière à faire apparaître la participation réelle de la science dans la construction d’une société et d’une identité européennes ». Six millions d’euros ont été engagés pour le Programme-cadre qui court jusqu’en 2013. Il s’agit bien là d’une ambition de représentation culturelle2.
À ce propos, Danièle André relève le paradoxe qui consiste à valoriser la science européenne quand l’ambition des scientifiques est, à son sens, d’être au service d’un savoir, sinon d’un langage, universel.
Le poids de Son regard
À l’instigation du modérateur l’analyse se porte sur l’un des textes réunis pour la session : «L’Œil d’Allah»qui évoque la problématique de la transmission d’une science arabe dans l’imaginaire scientifique anglais, en insistant sur les difficultés résultant de la charge religieuse qui lui était associée. Claude Ecken lit le poème associé à la nouvelle, qui pose bien la question des rapports entre la religion et la science : « fut-ce au mépris de son âme, nul ne peut reculer ni avancer cette heure par le Ciel dictée, annoncée par le sang de tous ces précurseurs qui ont rêvé trop tôt », c’est-à-dire, l’heure de la découverte. Daniel Tron y voit l’expression d’un regret de Kipling par ailleurs chantre de la supériorité intellectuelle des Anglais : que n’auraient-ils fait s’ils avaient disposé plus tôt du microscope? L’acceptation des dogmes religieux, la persécution des précurseurs, est-elle un prix trop élevé à payer ? La question n’a rien d’anodin pour Kipling, chez lequel les références bibliques sont légion. Éric Picholle rappelle que, en dépit du caractère très anglais de la nouvelle, elle vaut pour le rapport aux sciences arabes de l’Europe médiévale tout entière. Estelle Blanquet rappelle que les sciences “arabes” visées par Kipling sont en réalité iraniennes (Perse). Elle y voit une reconstruction erronée, elle-même tout à fait représentative d’une mythologie scientifique européenne. Anouk Arnal sourit du nombre d’acteurs politiques différents s’attribuant aujourd’hui la paternité du très actuel projet I.T.E.R. Simon Bréan rappelle que revendiquer celle d’un grand instrument, alors même que la plupart sont aujourd’hui le fruit d’une initiative et d’un financement internationaux, reste plus aisé que de s’attribuer une découverte qui, d’emblée, semble appartenir à l’humanité toute entière. Il y a toutefois des contre-exemples particulièrement révélateurs : la physique quantique en est un.
La Nation quantique
La mécanique quantique est, incontestablement, l’une des révolutions scientifiques majeures du XXe siècle et résulte en bonne partie d’une réflexion venue d’Europe du Nord, Allemagne en tête. Niels Bohr fonde l’école de Copenhague à partir d’une démarche délibérément exclusive, voire élitiste: en imposant un formalisme mathématique extrêmement rigoureux comme unique moyen légitime d’expression de leurs résultats, ce petit groupe de théoriciens inhibe toute diffusion de la physique des quanta dans le grand public. Dans un tel contexte, l’attitude d’Albert Einstein, allemand lui-même, d’origine juive et installé en Suisse puis aux États-Unis, est très révélatrice. Il adopte une démarche à l’opposé de celle de Bohr et de l’École de Copenhague : il communique sur ses découvertes et cherche à les rendre accessibles au public. Au-delà de ce bras de fer germano-germanique entre Bohr et Einstein, il y a aussi les quanticiens français (Louis de Broglie, Léon Brillouin), anglais (P. A. M. Dirac) qui tentent de contourner l’école de Copenhague et d’aborder la physique quantique chacun à sa manière. Toutefois, Dirac se rallie à Copenhague, Einstein est marginalisé par ses duels d’interprétations avec Bohr, et Louis de Broglie est trop isolé pour porter à maturité sa ”mécanique ondulatoire”, pourtant formellement équivalente aux autres théories en lice. Rallié à son tour, de Broglie va enseigner pendant près de vingt-cinq années l’interprétation orthodoxe de la mécanique quantique. Lorsque, au début des années 1950, il tente de réintroduire son interprétation alternative “de la double solution”, il est à son tour vivement critiqué, rejeté par une communauté scientifique acculturée à l’interprétation probabiliste de Copenhague, et rapidement marginalisé.
Ugo Bellagamba se demande si la constitution d’une “école”, comme celle de Copenhague, n’a pas été précisément, le moyen d’ancrer dans l’imaginaire scientifique collectif une référence au moins nominale à des idées trop difficiles pour s’y intégrer spontanément. Alors même que ses concepts de base restent étrangers à la plupart des gens — communautés scientifique et SF à part — la mécanique quantique fait aujourd’hui partie de la culture scientifique globale.
Mais sa véritable assimilation au-delà d’un petit cercle de spécialistes, reste relativement récente (années 1980); pendant près de 50 ans, le formalisme de Copenhague a induit une sorte d’inhibition même parmi les physiciens professionnels. C’est aussi l’une des raisons majeures pour lesquelles la physique quantique n’a pratiquement connu aucune application jusqu’à la guerre, y compris du côté des États-Unis qui, en général, sont les champions de la physique appliquée. Hiroshima (1945) est la première véritable application quantique. De surcroît, même la science-fiction a “évité” pendant longtemps de s’affronter à une physique quantique (antérieure à la multiplication des pulps) qu’elle ne comprenait pas, à l’exception, notable, de Robert Heinlein, dans les années soixante-dix.
Sous les drapeaux, l’espace !
C’est l’occasion de passer à la question de la place des productions culturelles, notamment littéraires, dans la constitution d’un imaginaire scientique national. Claude Ecken ouvre le feu en citant la très célèbre nouvelle de Cartmill, « Deadline » (1944), publiée dans Astounding, qui évoquait la bombe atomique avant que celle-ci ne soit achevée à Los Alamos. L’impact de ce texte, qui a provoqué une descente du F.B.I. dans les locaux de la revue de John Campbell, est peut-être moins dû aux lignes de Cartmill elles-mêmes qu’aux illustrations suggestives qui l’accompagnaient, figurant avant l’heure, un champignon atomique. Paradoxalement, le texte était très approximatif sur la théorie et ne permettait nullement de construire une bombe A. C’est que la science-fiction utilise surtout les images de la science, et non les théories elles-mêmes : ainsi, cite Timothée Rey, dans L’Éveil d’Endymion de Dan Simmons, un personnage enfermé dans un caisson de Shrödinger dans lequel un gaz mortel doit être libéré d’une seconde à l’autre, prend des notes et il est considéré par l’auteur, tout comme le chat de l’allégorie, tout à la fois mort “et” vivant. Claude Ecken revient sur la science-fiction d’avant les années 1980, rappelant qu’elle utilisait aussi les noms célèbres pour désigner des techniques imaginaires de propulsion de vaisseaux supraluminiques, ou capables de vitesses relativistes. Heinlein, une fois encore, est l’un des premiers à revendiquer la cohérence scientifique interne de ses univers de fiction. Il ne se contente pas d’utiliser les mots et les images de la science. Il cherche à en retracer la cohérence logique.
Intrications
Jean-Luc Gautero revient sur l’expérience quantique d’Alain Aspect, entre 1980 et 1982, qui a permis de vérifier la violation des inégalités de Bell, en apportant une réponse véritablement expérimentale au paradoxe Einstein-Podolsky-Rosen (E.P.R.) à propos du caractère non-indépendant de deux systèmes quantiques dits “intriqués”. Le paradoxe résultait d’une expérience de pensée qui mettait en lumière, d’après ses auteurs, soit le caractère incomplet de la physique quantique, soit la possibilité pour une influence de se déplacer à une vitesse supraluminique, ce qui remet en cause la causalité. Deux hypothèses inacceptables pour les quanticiens orthodoxes. Timothée Rey rappelle que Michel Houellebecq a tenté une “récupération” de l’expérience d’Aspect dans ses Particules Elémentaires en 1998, roman qui relève, de façon très marginale, de la science-fiction. Le roman de Houellebecq travaille par l’analogie, ce qui, du point de vue de Simon Bréan, est très différent de la manière dont Kipling reproduit le phénomène d’induction avec «Sans fil» où il s’agit beaucoup plus d’une homologie.
Et les sciences sociales ?
Yannick Rumpala oriente le débat sur la psychohistoire d’Isaac Asimov, et se demande si la science d’Hari Seldon relève de l’imaginaire scientifique. Simon Bréan y voit un bon exemple d’ingénierie sociale permise par l’expérience de pensée, à partir de l’histoire et de la psychologie, que constitue la figure narrative de la seconde fondation. Celle-ci a pour but de prévoir le comportement des ensembles humains à l’échelle stellaire, et d’orienter celui-ci dans une certaine direction.
Timothée Rey évoque «Nulle part à Liverion» de Serge Lehman (1996), par comparaison : l’abstraction d’Asimov y est remplacée par une étude approfondie des textes médiévaux, à la recherche d’une manière juridique de justifier au XXIe siècle l’appropriation privée de territoires par les grandes multinationales. Le message de Lehman est politique, celui d’Asimov d’ordre philosophique.
Faut-il y voir un trait de l’imaginaire scientifique national, ici appliqué aux sciences sociales ? Le recours aux intellectuels et à l’expertise des meilleurs historiens a été, dans la réalité, fait par les Américains pour mieux comprendre, tardivement, le terrain culturel-cultuel complexe dans lequel ils se sont rués avec la seconde guerre du Golfe. Ce qui compte ici, c’est la tentative d’appliquer la méthode des sciences exactes aux sciences sociales et, par ricochet, d’en permettre l’efficacité. Éric Picholle évoque la thermodynamique, science qui permet de ramener à quelques variables collectives (pression, température, etc.) le comportement de systèmes complexes (les particules de gaz, immensément nombreuses, qui vont remplir une pièce, par exemple). Paradoxalement, quoique bien trop nombreux pour un suivi en direct, les six milliards d’individus qui peuplent la Terre constituent un “petit nombre” au regard du nombre d’Avogrado (6 1023, le nombre d’atomes dans douze grammes de carbone) prisé par les physiciens. Isaac Asimov se donne une plus grande échelle pour se rapprocher des nombres d’individus à partir desquels s’appliquent les lois de la thermodynamique, et concrétise le fantasme de la réduction de l’humanité à quelques variables opératoires.
Si la dimension nationale de cet imaginaire asimovien n’a rien d’évident, dans Les Nouveaux discours du Docteur O’Grady (1947), l’académicien français André Maurois attribue à Talleyrand la paternité du terme de psychohistoire. Il la réinjecte dans une analyse qui relève purement des sciences sociales, ce qui est particulièrement intéressant, car une telle réponse, résolument nationale, vient d’un français qui se trouve être un fin connaisseur des Etats-Unis et de leur histoire.
Yannick Rumpala confirme que le terme de psychohistoire est présent aujourd’hui dans certaines études sociales qui en viennent à l’envisager comme un instrument utile pour analyser les comportements collectifs, notamment en termes de gestion d’entreprise. Et les progrès de l’informatique et des réseaux ont permis de multiplier les expériences sur des grands groupes virtuels, ce qui laisse supposer d’éventuelles applications pratiques à l’avenir. Ainsi, la World Corporation, sorte de Think Tank dont se sert le Pentagone, a travaillé sur la manière dont peuvent s’auto-organiser les manifestations contestataires, notamment les nouvelles qui prennent des formes réticulaires et sont moins prévisibles qu’auparavant, car elles interagissent comme des “foules intelligentes”. Ces nouveaux phénomènes d’essaims sont directement permis par la technologie, notamment celle de la communication (téléphones portables connectés au réseau mondial et/ou utilisant les SMS/MMS).
Where no man has gone before...
Simon Bréan se demande alors dans quelle mesure la technologie a un effet sur les représentations de la Nation. Roland Wagner évoque un exemple : la pilule. Les nations dans lesquelles la contraception est devenue courante voient se réduire considérablement, dans leurs productions de fictions, les histoires dramatiques de filles-mères. L’impact social de la technologie est évident. Mais contribue-t-il à modifier les représentations propres de la Nation, ou l’expression de sa volonté ? Estelle Blanquet prend un autre exemple : à Pékin, au moment de l’épidémie de S.R.A.S. (syndrome respiratoire aigu sévère) en 2002, l’utilisation des téléphones portables a obligé les autorités à en anticiper l’annonce officielle.
La discussion se porte sur l’impact des séries TV et des films de cinéma sur l’imaginaire scientifique national, non négligeable, ne serait-ce que pour une question de diffusion. Star Trek, pour suivre l’exemple pris par Daniel Tron, a véhiculé les notions de frontière et de mission civilisatrice qui sont au cœur de la nation américaine, et pour lesquelles la technologie spatiale peut être considérée comme un instrument. La conquête spatiale est une réalisation scientifique, basée sur un objet technique (la navette) dans lequel se reconnaît le peuple américain. La preuve en est que, dans le contexte troublé de l’après 11 septembre 2001, le président Georges Bush, afin de redonner aux ambitions américaines un sens qui ne soit pas en porte-à-faux avec les valeurs traditionnelles du pays a relancé le programme spatial et proclamé la nécessité de retourner sur la Lune, forme alternative de conquête territoriale.
A l’appui de l’influence de Star Trek, Sylvie Denis cite un article récent de Gary Westfahl3, portant sur une étude de Michele Barrett et Duncan Barrett, Star Trek : The Human Frontier (2001)
Pour Daniel Tron, la singularité de la navette sur le plan des représentations s’explique par le fait que le pilote paraît avoir la maîtrise de l’objet technique, comme dans les séries TV, et n’est pas un simple poids mort embarqué à bord d’une fusée automatisée, commandée du sol. Le fait que Star Trek soit bien connu (et régulièrement diffusé) en France, bien qu’elle ait fait l’objet d’un certain mépris (ce qui est une exception française, comme l’a bien montré le documentaire Trekkies en 1997) a permis une certaine acculturation de la conception américaine de la conquête spatiale, qui se ressent dans la manière dont les français lisent, et parfois écrivent, de la science-fiction. Simon Bréan rappelle toutefois la différence entre Trekkies et Trekkers, supposés moins hystériques que les premiers, et plus concentrés sur les aspects spéculatifs de la série et de la littérature de science-fiction en elle-même. Les premiers sont souvent moqués, y compris aux États-Unis. Là encore, c’est la diffusion de la série qui détermine l’irrigation des imaginaires scientifiques nationaux: moins bien diffusée, en France même, que les séries américaines, la science-fiction française y perd de fait toute influence.
Synthèse
Cette session sur l’imaginaire scientifique national a permis de dégager une série de conclusions éclairantes :
1) La langue, si elle n’est pas le seul élément constitutif de la nation, contribue à façonner l’imaginaire scientifique et modifie le rapport à l’objet technique, y compris dans la fiction.
2) Si la recherche scientifique peut faire l’objet d’une appropriation nationale, c’est dans ses méthodes et ses modalités plutôt que dans ses résultats eux-mêmes.
3) Les productions audiovisuelles (séries TV, cinéma) contribuent, autant que la littérature, à la constitution d’un imaginaire scientifique national (e.g. : Star Trek).
Simon Bréan
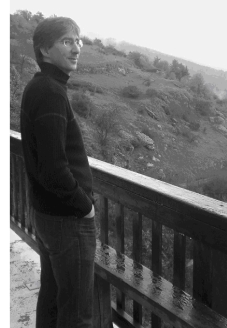
Notes de bas de page numériques
1 C. Babbage, Reflections on the Decline of Science in England, and on Some of Its Causes, 1830. Cet ouvrage essentiel ne semble pas avoir été traduit.
2 www.eurosfaire.prd.fr/sciencesociety/
3 G. Westfahl, «A Civilized frontier», in Science Fiction Studies, 87, vol. 29,part. 2, July 2002 ; http://www.depauw.edu/sfs/review_essays/westfahl87.htm
Annexes
Liste des participants
Roger Bozzetto
Daniel Tron
Katariina Roubier
Ugo Bellagamba
Danièle André
Timothée Rey
Sylvie Denis
Eric Picholle
Jean-Luc Gautero
Louis Butin
Claude Ecken
Estelle Blanquet
Anouk Arnal
Yannick Rumpala
Roland C. Wagner
Pour citer cet article
« Y a-t-il un imaginaire scientifique national ? », paru dans Sciences et Fictions, Rudyard Kipling et l'enchantement de la technique, Session 5, Y a-t-il un imaginaire scientifique national ?, mis en ligne le 27 avril 2010, URL : http://revel.unice.fr/symposia/scetfictions/index.html?id=535.
Modérateurs
Littérature comparée, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, silramil@yahoo.fr




